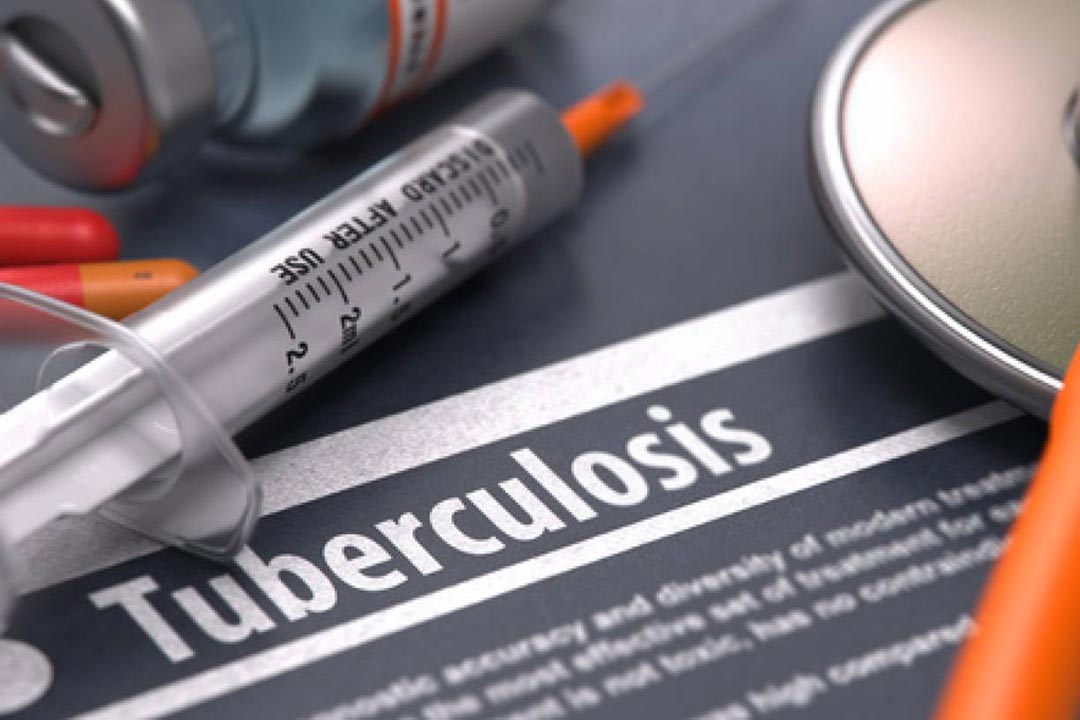Se préparer à affronter l'inconnu : comment être prêt pour la prochaine pandémie
Le professeur sud-africain Salim Abdool Karim, spécialiste des maladies infectieuses, explique comment se préparer à la prochaine pandémie, même si l’on en ignore encore la nature.
- 17 octobre 2024
- 9 min de lecture
- par Mandy Collins
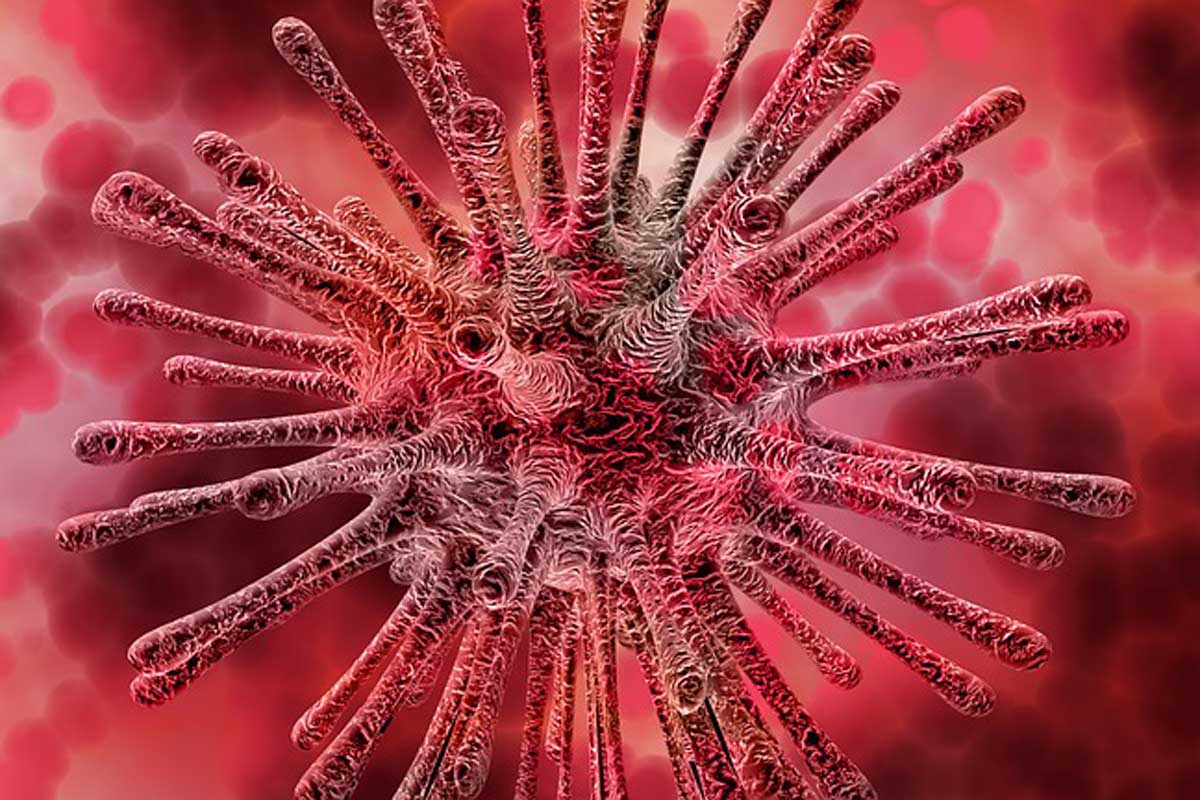
Au fur et à mesure de la progression de la pandémie de COVID-19, les Sud-Africains se sont habitués à voir le professeur Salim Abdool Karim à la télévision leur exposer les connaissances scientifiques sur le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19, sur la façon dont il mute et sur la riposte mondiale à la pandémie.
En pleine crise sanitaire, ses interventions ont eu un effet d’apaisement. Il émane quelque chose de très rassurant de ce médecin épidémiologiste et virologue, spécialiste de la santé publique, qui a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les pandémies de SIDA et de COVID-19, aussi bien dans son pays qu’à l'étranger. Parler avec lui, c'est un peu comme parler à son oncle préféré. Il est très chaleureux et il a la rare capacité de rendre accessibles et facilement compréhensibles des concepts scientifiques complexes et rébarbatifs. Il signe simplement ses courriels du nom de “Slim”, comme l'appellent ses amis et ses collègues.
Sa modestie l’empêche d’évoquer les nombreuses distinctions et récompenses dont il est titulaire. Respecté internationalement dans son domaine, il a été nommé en 2022 conseiller spécial en matière de pandémies auprès du Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il fait ainsi partie de l’équipe qui aide cette organisation mondiale dédiée à la santé à se préparer à la prochaine pandémie.
« Selon toute vraisemblance, il s'agira d'un nouveau virus contre lequel nous n'aurons aucune immunité. »
« Je dépends directement du Dr Tedros et je consacre environ 10 à 20 % de mon temps, soit une demi-journée par semaine, à collaborer avec l'OMS dans ce domaine », explique le Prof. Abdool Karim. « Je passe donc une partie de mon temps à me rendre à l'OMS à Genève ou à Berlin, où se trouve le centre OMS de lutte contre les pandémies.
« Mon rôle est purement consultatif ; je n'ai aucune autorité réelle », ajoute-t-il en souriant. « Je dois simplement chuchoter des conseils scientifiques à l'oreille de certaines personnes. Elles sont tout à fait libres de suivre ou non ce que je leur suggère ».
Il a beaucoup chuchoté de conseils au cours de sa carrière : au plus fort de la pandémie de COVID-19, il a principalement conseillé le gouvernement sud-africain, puis les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) de l'Union africaine. Mais il a également informé et conseillé de nombreux autres gouvernements, dont ceux des États-Unis et du Royaume-Uni.
Abdool Karim explique que la politique de l’Afrique du Sud en matière de préparation à la pandémie remonte à 1993, date de la création du Groupe consultatif national sur la vaccination (National Advisory Group on Immunization ou NAGI), alors qu’à cette époque le Congrès national africain (ANC, pour African National Congress) était encore un mouvement de libération et n'avait pas encore pris les rênes du pays. « Un comité mixte composé de représentants du gouvernement et de l'ANC a été mis en place pour commencer à se préparer face au risque de pandémie de grippe », poursuit-il. Il a fait partie des personnes désignées pour y siéger.
« Nous avons commencé à élaborer un plan de préparation aux pandémies parce tout le monde s'attendait à voir surgir une pandémie de grippe en 1994 ou en 1995 », explique-t-il. « La grippe revient cycliquement, et l’on s’attendait à ce qu’elle frappe à nouveau. »
Sous la direction du professeur Barry Schoub, alors directeur de l'Institut national de virologie d'Afrique du Sud, le comité a mis en place une structure et un ensemble d'activités, programmé des mesures de surveillance et élaboré des plans pour l'acquisition de vaccins. « Nous avons également dit au gouvernement que la principale chose dont nous avions besoin, c’était le [médicament antiviral] Tamiflu, parce que c'était le produit qui permettrait de sauver les personnes âgées », se souvient-il. « Nous leur avons suggéré de l'acheter à l'avance - car il n'y aurait pas de stocks disponibles pour l'Afrique du Sud en cas de pandémie - et de le stocker, ce qu'ils ont fait. » Au final, la pandémie de grippe ne s'est jamais matérialisée, mais selon lui, il s'agissait à l’époque d'un plan particulièrement clairvoyant.
« En ce qui concerne la COVID-19, la situation était très différente », affirme-t-il. « Presque tout le monde a été pris au dépourvu. Nous n'étions pas préparés à affronter un virus respiratoire avec un taux de reproduction (R0) se situant autour de trois, et contre lequel nous n'avions aucune immunité. Nous ne disposions d'aucun vaccin ou traitement. Et nous étions mal préparés. »
Selon Abdool Karim, plusieurs alertes avaient été lancées sur le fait que les coronavirus pouvaient être à l'origine d'épidémies de maladies respiratoires : la première, avec l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en Chine et à Hong Kong en 2002, et ensuite, avec le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2012. « Le coronavirus responsable du SRAS n'était pas très infectieux, mais nous avions déjà appris en 2002 qu’il pouvait passer chez l'homme par le biais d'un hôte intermédiaire et provoquer une situation de type épidémique. Le MERS est également un virus peu infectieux, qui a donc pu être contenu, mais son apparition en 2012 a montré que l’on devait s’attendre à l’émergence d’un nouveau coronavirus tous les huit à dix ans ». Et c'est ce qui s'est passé.
« Sachant que le SARS-CoV-2 est apparu en 2019, il nous faut être prêts huit ans plus tard, soit en 2027 ; juste au cas où », déclare-t-il. « Personne n'a de boule de cristal, mais il serait un peu fou d’affirmer que cela ne se produira pas, sachant que cela s'est déjà produit. Nous devons donc travailler en partant du principe que cela va forcément se reproduire.
« On avait déjà constaté [en 2012] qu’un nouveau coronavirus pouvait émerger tous les huit à dix ans. « Sachant que le SARS-CoV-2 est apparu en 2019, il nous faut être prêts huit ans plus tard, soit en 2027 ; juste au cas où. Personne n'a de boule de cristal, mais il serait un peu fou d’affirmer que cela ne se produira pas, sachant que cela s'est déjà produit. Nous devons donc travailler en partant du principe que cela va forcément se reproduire.
« Nous devons tous nous poser la question suivante : Serons-nous protégés par notre immunité » ? La réponse à cette question, c’est que nous n’en savons rien. Mais selon toute vraisemblance, il s'agira d'un nouveau virus contre lequel nous n'aurons aucune immunité. »
Une approche articulée autour de trois grands axes
La difficulté, c’est qu’il faut se préparer à quelque chose que l’on ne connaît pas encore. « Dans ce cas, il faut travailler suivant trois grands axes », constate Abdool Karim. « Premièrement, il faut mettre en place un système de surveillance, car le meilleur moment pour prévenir les pandémies, c’est avant qu'elles n’éclatent.
« Deuxièmement, il faut mettre en place un dispositif gouvernemental comprenant une structure de pilotage et de coordination, une structure pour le financement, et des équipes habilitées à prendre des décisions. Il convient également de s’assurer de la disponibilité des fonds nécessaires. Ce dispositif sera doté d’un programme, lequel devrait de préférence être encadré par des textes de loi, car les mesures de lutte contre les pandémies ont de nombreuses implications juridiques. Pour que cela fonctionne, il faut disposer d'un système de soins de santé performant capable de mettre en œuvre ces mesures dans les hôpitaux, les laboratoires et la communauté.
« Troisièmement, il faut pouvoir élaborer des contre-mesures biomédicales, que l’on peut classer en trois grands groupes : (1) les outils diagnostiques ; (2) les vaccins ; (3) les traitements, qui comprennent non seulement les médicaments, mais aussi les respirateurs, l'oxygène médical, etc. »
La plupart des pays se concentrent sur les deux dernières catégories, qui font partie de l'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies qui devait être conclu le 24 mai de cette année, après deux ans de négociations. Toutefois, de sérieux désaccords sont apparus sur la quantité de produits devant être réservés par les sociétés pharmaceutiques pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, ainsi que sur les droits de propriété intellectuelle.
« Plusieurs pays ont refusé d'inclure dans le traité la moindre disposition relative à l'équité en matière de propriété intellectuelle », confie le Dr Abdool Karim. « Pour eux, les contre-mesures biomédicales sont un moyen de faire du profit. L'Union africaine a proposé un texte en faveur de l'équité, mais il a été rejeté.
« Le texte original stipulait que les pays ayant développé une contre-mesure biomédicale étaient tenus d'en mettre 50 % à la disposition d'un mécanisme international de distribution équitable comme COVAX », explique-t-il. « Mais certains pays riches ont considéré que c’était inacceptable. Ils veulent tout garder pour eux.
Les inégalités dans la distribution des vaccins constituaient un problème majeur alors que le monde était aux prises avec la COVID-19. C’est pour y remédier qu’ont été conçues des initiatives comme COVAX - l'un des trois piliers de l'Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (ACT).
Pour aller plus loin
COVAX a réussi à rassembler les gouvernements, les organisations mondiales dédiées à la santé, les producteurs de vaccins, les scientifiques, le secteur privé, la société civile et le monde de la philanthropie, dans le but de fournir un accès innovant et, surtout, équitable aux diagnostics, traitements et vaccins contre la COVID-19.
Il s'agissait en fait d'une sorte de précurseur de l'accord sur la pandémie, actuellement en cours de négociation. « Je n'avais pas réalisé à quel point certains pays tiennent aux inégalités », déplore Abdool Karim.
« Quand les pays choisissent délibérément d'être amoraux en protégeant et en encourageant un mode de fonctionnement basé sur le ‘moi d'abord’, il est très difficile de les convaincre d’adopter une autre attitude. Je comprends dans une certaine mesure que les dirigeants veuillent d'abord protéger leurs propres citoyens. Mais à un certain point, il faut reconnaître que les virus ne respectent pas les frontières nationales. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de ‘pandémie’.
« Aucun pays ne peut contrôler isolément un virus pandémique qui se propage rapidement, et qui est présent partout ailleurs dans le monde - comme nous l'avons vu avec Omicron. La riposte aux pandémies doit être une riposte mondiale, et pas seulement une réponse nationale ».
Responsabiliser les cliniciens
Pour revenir à la question de la surveillance, le Prof. Abdool Karim estime que, pour disposer d’un système d'alerte précoce solide, il faut donner des moyens aux cliniciens, qui constituent la première ligne de défense. « Les pandémies sont presque toujours identifiées à l’origine par un clinicien avisé », déclare-t-il. « Si l'on y réfléchit bien, qui a identifié la pandémie de sida ? C'est un médecin du CDC américain qui a vu toutes ces demandes de pentamidine en provenance de Californie et de New York pour traiter des pneumonies à pneumocystis carinii. Il a constaté que les patients étaient tous des hommes homosexuels, et c'est ainsi que le sida a été identifié pour la première fois dans le numéro du 5 juin 1981 du Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR - rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité).
« En ce qui concerne la COVID-19, les docteurs Zhang et Li, de l'hôpital de district de Wuhan, ont observé des pneumonies d’étiologie inconnue et se sont rendu compte qu'ils avaient affaire à une maladie infectieuse inhabituelle. Inquiet de voir que ses rapports n’étaient pas pris au sérieux par les autorités du district de Wuhan, le Dr Li a commencé à écrire des messages sur WeChat à propos de des cas de pneumonie inexpliqués, à tel point que la police s'est rendue chez lui pour le sommer de cesser de répandre des rumeurs sur ces cas de pneumonie. Mais il s'est avéré qu'il avait raison.
« Il existe de nombreux autres cas où les cliniciens ont joué un rôle déterminant dans l'identification précoce des épidémies et des pandémies. Même les cas de maladie à virus Ebola ont été initialement identifiés par des cliniciens de la République démocratique du Congo. »
Pour lui, cela s’explique facilement. Quand un nouvel agent pathogène commence à se propager, on ne sait pas ce que c'est, et on n'a pas de test qui permette de le détecter, de sorte qu'on ne peut pas l'identifier en laboratoire. C’est la clinique qui permet d’indiquer que l'on a affaire à quelque chose d'inhabituel ; ensuite les laboratoires vont pouvoir identifier l'agent causal.
« Mais ce sont les cliniciens qui sont les premiers à détecter la pandémie proprement dite. C’est pourquoi nous avons besoin de cliniciens vigilants, qui identifient les premiers cas, et avertissent les autorités du district ou les autorités nationales chargées des maladies infectieuses, maillons essentiels de la chaîne permettant de riposter immédiatement pour endiguer efficacement la pandémie à son début.
C'est en partie la raison d'être du Centre OMS de Berlin consacré à la collecte de renseignements sur les pandémies et les épidémies. L'un de ses programmes consiste à travailler avec les agences nationales chargées des maladies infectieuses et de la santé publique, qui toutes doivent assurer la surveillance, recevoir la notification des nouvelles maladies et agir en conséquence, c'est-à-dire d'être à l'écoute des médecins qui lancent des alertes.
Si la pandémie de COVID-19 a entraîné d'immenses problèmes, il est réconfortant de savoir que des experts comme Abdool Karim travaillent déjà en coulisses pour être prêts à affronter la prochaine pandémie. On peut espérer qu'en donnant la priorité aux mesures pratiques de préparation et en renforçant la coopération internationale, nous pourrons faire face aux futures épidémies non seulement avec résilience, mais aussi de façon proactive et équitable, C’est ainsi que nous pourrons non seulement préserver la santé publique, mais aussi en construire un avenir plus sûr pour tous.