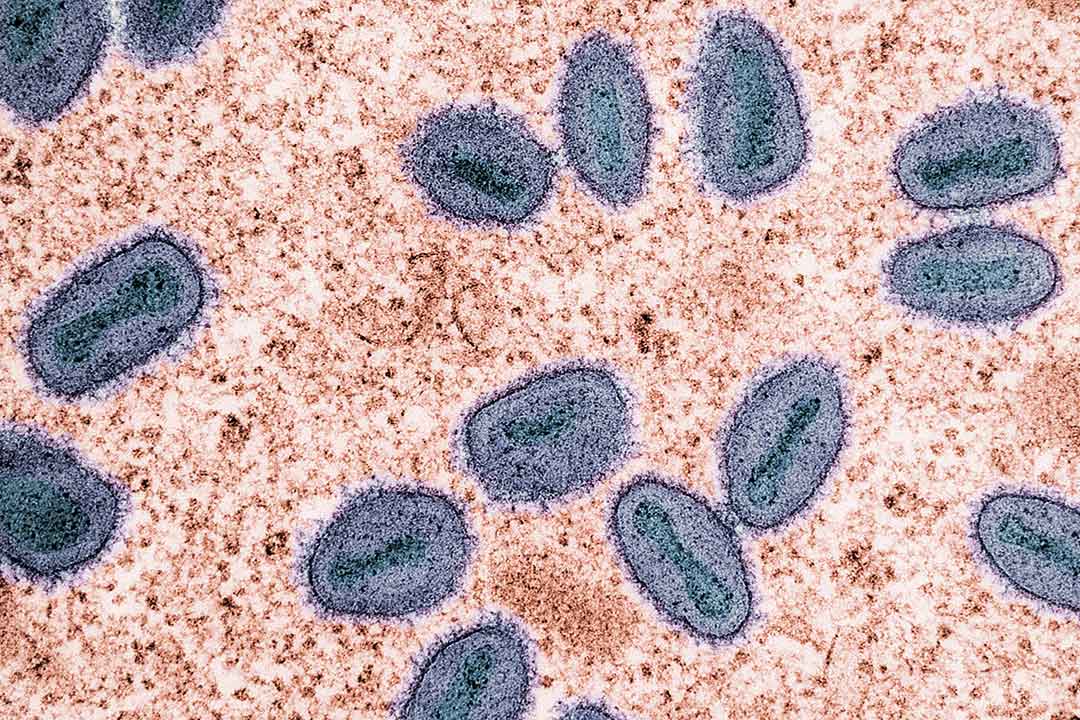Huit clés pour comprendre les études scientifiques
Un guide pratique pour faire le tri entre recherches bancales et science solide.
- 26 septembre 2025
- 7 min de lecture
- par Linda Geddes

Chaque année, des millions d’études scientifiques sont publiées. Certaines sont de véritables avancées, avec des conséquences majeures pour la médecine, la technologie ou d’autres domaines de la science.
Mais beaucoup d’autres sont de nature exploratoire, avec des résultats susceptibles d’être remis en question ou affinés par des recherches ultérieures, tandis qu’une petite proportion souffre de méthodologies défaillantes ou d’une qualité scientifique médiocre.
Pas besoin d’un diplôme de sciences pour savoir quelles études méritent votre attention et lesquelles finissent à la poubelle. Voici huit règles simples pour repérer la bonne science… et la mauvaise.
Malheureusement, Internet regorge d’affirmations pseudo-scientifiques qui déforment les résultats d’études rigoureuses ou s’appuient sur des recherches de piètre qualité.
Même si déterminer quelles recherches sont fiables peut sembler intimidant, la bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait des études de sciences pour savoir lesquelles méritent votre attention et lesquelles finissent à la poubelle. Voici huit règles simples pour repérer la bonne science… et la mauvaise.
1. Où la recherche a-t-elle été publiée ?
Un bon point de départ est la revue dans laquelle une étude a été publiée. Les meilleures revues envoient chaque article qu’elles envisagent de publier à des experts du même domaine, qui l’analysent attentivement, en repèrent les faiblesses et suggèrent des améliorations. Si l’article ne répond pas aux critères de la revue, il est rejeté ou renvoyé pour révision.
Bien que ce système « d’évaluation par les pairs » ne soit pas infaillible, c’est le meilleur dont dispose aujourd’hui la science pour filtrer les études faibles ou trompeuses.
Une recherche rapide permet généralement de savoir si une revue soumet ses articles à l’évaluation par les pairs. Vous pouvez aussi regarder son « facteur d’impact » – c’est-à-dire à quelle fréquence, en moyenne, ses articles sont cités par d’autres chercheurs. Vous pouvez également coller le titre de l’étude dans Google Scholar et vérifier combien de fois cette étude en particulier a été citée.
Soyez particulièrement prudent avec les études publiées sous forme de prépublications (« preprints »). Elles n’ont pas encore été examinées par des experts, ce qui signifie que leurs méthodes, données et conclusions peuvent comporter des erreurs, des exagérations ou des failles qui feront qu’elles ne seront jamais publiées dans une revue reconnue.
Même si les prépublications permettent de partager rapidement des découvertes prometteuses, elles peuvent aussi contribuer à diffuser de la désinformation.
2. Quand l’étude a-t-elle été publiée ?
La science évolue vite. À mesure que les méthodes s’améliorent et que de nouvelles données s’accumulent, les résultats peuvent être révisés, voire complètement remis en cause.
Cela ne veut pas dire que les études anciennes sont inutiles, mais si une étude a plus de cinq à dix ans, il est préférable de vérifier si ses résultats ont été confirmés par des recherches ultérieures et par d’autres équipes.
Une bonne approche consiste à consulter les revues de synthèse et les méta-analyses récentes, qui rassemblent les résultats de nombreuses études et aident à clarifier des conclusions parfois contradictoires. Les revues Cochrane sont considérées comme la référence en la matière dans le domaine de la santé.
3. Qui sont les auteurs ?
Le fait qu’une personne porte le titre de « Dr » ou de « Professeur » ne garantit pas qu’elle ait une expertise dans le domaine précis traité par l’article.
Un manque d’expérience pertinente peut soulever des questions sur la qualité de la recherche, en particulier si ses résultats contredisent des travaux établis ou paraissent dans une revue peu réputée.
Vous pouvez vérifier les précédentes publications et l’expertise d’un auteur en consultant une base de données comme PubMed ou ResearchGate, ou simplement en effectuant une recherche en ligne.
Prêtez une attention particulière au premier et au dernier auteur listés dans l’article : le premier est généralement celui qui a mené la majorité des expériences et rédigé le manuscrit, tandis que le dernier est en général un chercheur senior qui a supervisé et encadré l’étude.
Soyez également attentif aux éventuels conflits d’intérêts, tels qu’un emploi ou un financement par une entreprise ou une organisation pouvant tirer avantage des résultats. Cela n’invalide pas automatiquement la recherche, mais il est essentiel d’en tenir compte dans l’interprétation des conclusions.
Les affiliations des auteurs figurent généralement en haut de l’article, tandis que la plupart des revues incluent aussi une section distincte pour les financements ou remerciements, ainsi qu’une déclaration de conflits d’intérêts, souvent en fin de texte.
4. Qui ou quoi fait l’objet de l’étude ?
La plupart des recherches médicales sont menées sur des cellules, des animaux ou des humains.
Les études sur les cellules sont très utiles pour comprendre les mécanismes biologiques, mais elles ne reflètent pas toute la complexité des organismes vivants.
C’est pourquoi les chercheurs passent généralement aux études animales, puis aux essais cliniques, qui évaluent la sécurité et l’efficacité des traitements chez l’être humain.
Parfois, des recherches qui paraissent convaincantes et sont citées dans les médias ou en ligne concernent en réalité des expériences sur des cellules ou des animaux, qui ne s’appliquent pas forcément aux humains.
Même les études menées sur des humains peuvent induire en erreur si les participants ne reflètent pas l’ensemble de la population. Il arrive que les chercheurs se concentrent sur des sous-groupes spécifiques pour de bonnes raisons – par exemple tester s’ils sont plus susceptibles de bénéficier d’un traitement particulier – mais cela peut rendre les résultats non pertinents pour le reste des personnes.
Pour aller plus loin
Attention également aux recherches épidémiologiques, qui étudient les schémas de maladies au sein des populations. Bien qu’elles puissent être très utiles pour repérer des tendances et des facteurs de risque potentiels, elles ont leurs limites.
Un écueil courant est de confondre corrélation et causalité : le fait que deux phénomènes se produisent ensemble ne signifie pas que l’un cause directement l’autre. Par exemple, les ventes de glaces et les attaques de requins augmentent toutes deux en été, mais manger une glace n’augmente probablement pas votre risque d’être mordu par un requin.
Des expériences complémentaires sur des cellules, des animaux et des humains sont généralement nécessaires pour déterminer si une corrélation implique réellement une relation de cause à effet.
5. Quelle est la taille de l’échantillon ?
En règle générale, plus l’échantillon d’une étude est petit, moins on peut avoir confiance dans ses résultats.
Parfois, de petites études sont nécessaires, par exemple dans le cas de maladies rares, et les bons chercheurs précisent généralement ces limites.
Les petites études peuvent aussi constituer un point de départ utile pour des recherches ultérieures, mais leurs résultats doivent être interprétés avec prudence jusqu’à ce qu’ils soient confirmés par des essais plus larges.
Les études qui incluent des milliers, voire des centaines de milliers de participants sont beaucoup plus susceptibles de produire des conclusions fiables.
6. Y a-t-il un groupe témoin ?
Dans les essais cliniques, les résultats des participants doivent être comparés à ceux d’un « groupe témoin » : un groupe de personnes qui n’a pas été exposé au traitement ou à la condition testée.
Pour réduire les biais, les participants ne devraient pas savoir s’ils se trouvent dans le groupe test ou dans le groupe témoin – on parle alors « d’étude en aveugle » – et dans une étude en double aveugle, même les chercheurs ignorent à quel groupe appartiennent les participants jusqu’à la toute fin.
Cependant, selon le type de traitement étudié, l’aveuglement n’est pas toujours possible – ni éthique.
7. Les résultats appuient-ils les conclusions ?
C’est probablement l’aspect le plus difficile à vérifier si vous n’êtes pas spécialiste du domaine, d’où l’importance de vérifier la réputation de la revue et de consulter des articles de synthèse qui rassemblent l’ensemble des preuves disponibles sur une question de recherche particulière.
Malgré tout, certains indices peuvent aider à y voir plus clair.
Un point important à garder en tête lorsqu’il s’agit de la couverture médiatique de résultats scientifiques est la différence entre « risque relatif » et « risque absolu ».
Le principal indice est de vérifier que les auteurs ont bien mesuré ce qu’ils affirment et qu’ils n’ont pas étiré ou extrapolé les données au-delà de ce qu’elles permettent de conclure.
Les bons chercheurs formulent leurs résultats avec des expressions comme « plus probable », « moins probable », « risque accru de » ou « risque réduit de ».
Ils précisent également clairement les limites de leur étude. Si un chercheur fait des affirmations trop catégoriques sur les implications de ses résultats pour une maladie ou une condition particulière, cela doit éveiller la méfiance.
Il est aussi pertinent de se demander si l’effet rapporté a une réelle importance dans la vie quotidienne : les résultats peuvent être statistiquement significatifs, mais la différence observée peut être si faible qu’elle n’a probablement pas d’impact pratique.
Un point important à garder en tête lorsqu’il s’agit de la couverture médiatique de résultats scientifiques est la différence entre « risque relatif » et « risque absolu ». Si un médicament fait passer le risque d’un effet secondaire spécifique de 1 personne sur 1 000 à 2 personnes sur 1 000, cela représente une augmentation de 50 % en termes relatifs, mais le risque réel (le risque absolu) reste seulement de 0,2 %.
8. Que disent les autres chercheurs de cet article ?
La science repose sur l’examen collectif : lorsqu’un chercheur avance une affirmation audacieuse ou controversée, il est utile de voir comment d’autres y réagissent dans les médias généralistes, les revues spécialisées et sur les réseaux sociaux.
Les sites de vérification des faits et les organisations de santé peuvent également se prononcer sur des études controversées, en fournissant un contexte précieux ou des avertissements : il est important de tenir compte de leurs recommandations.
Davantage de Linda Geddes
Recommandé pour vous