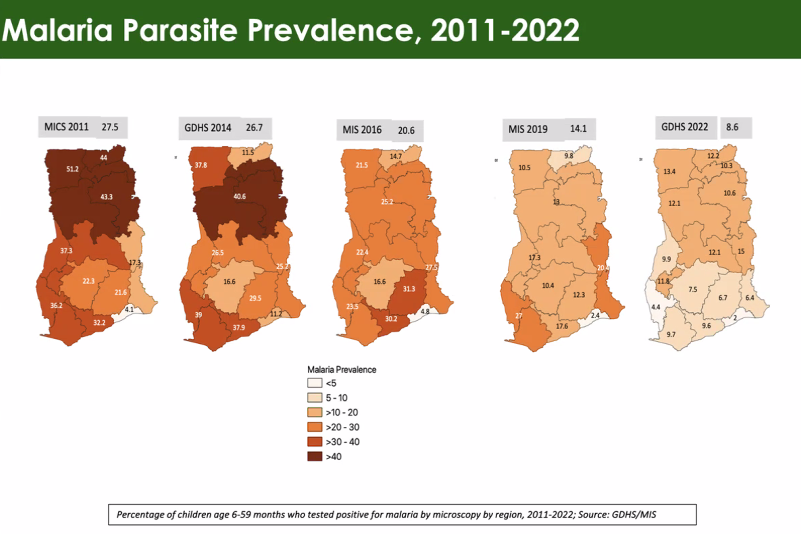Au Kenya, les aflatoxines pourraient augmenter le risque de cancer du col de l'utérus
Au Kenya, une nouvelle étude scientifique vient mettre en lumière un lien entre l’infection aux aflatoxines et celle aux papillomavirus. Le poison naturel pourrait favoriser le cancer du col de l’utérus, mais de plus amples recherches sont nécessaires.
- 4 mars 2024
- 5 min de lecture
- par Claudia Lacave

Dans les locaux de l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) en banlieue de la capitale du Kenya, l’air climatisé et les néons tranchent avec l’extérieur chaud et luxuriant de ce mois de février. Les blouses blanches se croisent dans le bruit des machines ; sur un mur, un panneau « Analyses des mycotoxines » indique le thème. « Les aflatoxines sont un problème. Mais nous ne l’exagérons pas car nous avons des règlementations qui dictent ce qui est autorisé à la consommation humaine donc l’essentiel est de réduire les risques », affirme Florence Mutua, chercheuse en sécurité alimentaire à l’ILRI. Ces toxines naturelles affectent une grande variété de cultures, majoritairement en Asie du Sud-Est et en Afrique sub-saharienne. Alors qu’elles sont reconnues comme cause de nombreux cancers du foie dans ces régions, une nouvelle étude indique qu’elles pourraient favoriser également les cancers du col de l’utérus.
Les aflatoxines, des substances chimiques produites par les champignons Aspergillus, prospèrent principalement dans les environnements chauds et humides. Elles affectent diverses cultures telles que le maïs, les arachides, le riz, le manioc, le sorgho, le millet et les ignames. Ces substances nuisibles attaquent les cultures soit directement sur le champ, soit après la récolte, en l'absence d'un stockage adéquat des produits.

Crédit : Claudia Lacave/Hans Lucas
Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estimait dans les années 2010 que 4,5 milliards de personnes dans les pays en développement pourraient être infectées par les aflatoxines. Au Kenya, comme dans la majorité des pays africains, le maïs est un aliment de base et sa consommation est évaluée à 400g quotidiens par personne, augmentant ainsi considérablement l’exposition de la population à la toxine.
Un poison invisible et mortel
Ce puissant agent cancérigène et immunosuppresseur, d’abord identifié en 1960 au cours d’une épidémie chez les dindes en Angleterre et en Afrique de l’Est, figure parmi les principales causes, non diarrhéiques, de décès d'origine alimentaire avec 20 000 victimes par an dans le monde. L’empoisonnement à des taux très élevés entraîne une défaillance du foie et peut être mortel, tandis que l’exposition prolongée induit des retards de croissance chez les enfants et favorise les cancers.
Au Kenya, comme dans la majorité des pays africains, le maïs est un aliment de base et sa consommation est évaluée à 400g quotidiens par personne, augmentant ainsi considérablement l’exposition de la population à la toxine.
En 2004, une des plus importantes flambées d’aflatoxines au monde a provoqué 500 maladies aiguës et 200 décès au Kenya. Depuis, les infections sont annuelles chez les agriculteurs de subsistance dans la province orientale du pays, avec des tests aléatoires révélant des taux de contamination du maïs variant entre 55 % et 86 %. De plus, une étude menée en 2017 a révélé la présence du poison dans 100 % des échantillons de lait maternel.
Un autre cancer sur la liste des risques ?
À l’ILRI, ce sont des échantillons de maïs blanc et jaune qui sont en train d’être testés. L’officier de laboratoire, Fredric Nganga, place les tubes de produits dilués avec 70 % de méthanol dans un agitateur. Il filtre ensuite la solution et l’apporte au spectromètre de masse qui en analyse le contenu et produit des diagrammes de données. La machine onéreuse et rare sert à tester les échantillons de nombreuses organisations mais n’a malheureusement pas la capacité de mesurer les taux d’aflatoxines dans le sang.
C’est pourquoi le Dr Philip Tonui a dû envoyer les échantillons de son étude à l’école de médecine Johns Hopkins de Baltimore, aux Etats-Unis. Le gynéco-oncologue pratique et enseigne à Eldoret, dans l’ouest du Kenya, où 90 % des tumeurs malignes qu’il voit sont des cancers du col de l'utérus. Son intérêt scientifique a été piqué. « Je suis parti d'une théorie selon laquelle, si les aflatoxines provoquent une immunodépression, il pourrait y avoir une interaction avec les papillomavirus (VPH) », se rappelle-t-il.
Pour aller plus loin
Le deuxième volet de sa recherche scientifique, menée avec une dizaine de collègues, a été publié en juin 2023 par BMC Infectious Diseases et souligne une corrélation effrayante : les femmes contaminées par les aflatoxines ont plus de chances d’être infectées par des HPV persistants et donc, de développer un cancer. Alors que 80 % de la population mondiale est atteinte de ces virus sexuellement transmissibles au moins une fois dans sa vie, le corps s’en débarrasse généralement seul. « Nos résultats indiquent qu'il existe un lien entre la présence d'aflatoxine dans l'organisme et l'incapacité à éliminer le virus dans le col de l'utérus. » L’étude calcule que pour ces patientes, le risque d’infection persistante aux HPV est de l'ordre de 25 à 35 %.
La boîte à outil multisectorielle
De plus amples recherches sont nécessaires pour établir le lien de cause à effet, mais des aflatoxines ont été trouvées dans les cellules cervicales et pourraient potentiellement agir directement sur celles-ci pendant le développement du cancer. Une autre hypothèse est l’impact néfaste sur les défenses immunitaires, qui pourrait affaiblir le corps face à l’attaque des VPH. La prochaine étude de l’équipe du Dr Tonui se concentrera sur l’effet des aflatoxines sur la capacité des femmes atteintes du VIH à lutter contre le virus.
En attendant de connaître l’étendue des risques de ce poison naturel, l’urgence est de limiter l’exposition de la population. Dr Florence Mutua détaille : « Le problème ne peut être résolu avec un seul outil. Nous devons identifier les opportunités de contamination, de la ferme au moulin. Lorsque toute la chaîne est sécurisée, nous sommes en sécurité. » Les solutions mises en avant pour le moment sont très diverses : croisements de variétés de plantes résistantes, épandage d’un pesticide dédié appelé Aflasafe, campagnes de sensibilisation auprès des acteurs de l’agriculture sur les bonnes pratiques de stockage, mais aussi auprès de la population globale sur la diversité alimentaire, décontamination à l’ozone des grains et renforcement des standards, entre autres.
Le Kenya a établi il y a longtemps des limites de concentration dans les aliments à destination de la consommation et les standards concernant le maïs ont été abaissés de nouveau en 2007 à 10 microgrammes (µg) par kilo. À titre de comparaison, le seuil européen (2006) s’arrête lui à 4 µg/kg pour ce produit, et à 10 µg/kg pour les amandes, noisettes et pistaches.
Suivez l'autrice sur Twitter : @C_Lacave