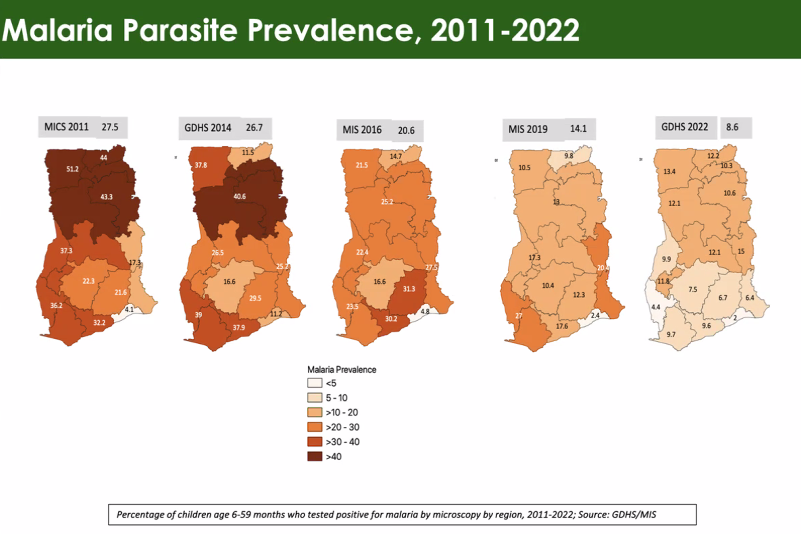On a parlé vaccins avec… Anthony Okara de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme
Depuis une quinzaine d’années, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme renforce la lutte menée par les différents pays du continent. Alors que la progression stagnait depuis 2019, un nouveau vecteur vient menacer les efforts déjà réalisés, sur fond de résistance grandissante aux interventions habituelles.
- 17 novembre 2023
- 6 min de lecture
- par Claudia Lacave

Depuis 2012 en Afrique et déjà répandu dans sept pays, l’Anopheles Stephensi est le dernier vecteur du paludisme en date à toucher le continent. Le moustique, originaire d’Asie du Sud et du Golfe, est porteur des parasites Plasmodium falciparum et vivax, les deux formes les plus dangereuses de la malaria. Il représente un défi d’ampleur pour l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA). L’organisation a été créée en 2009 dans le but de soutenir les cinquante-cinq États-membres et coordonner leurs efforts pour éradiquer l’épidémie d’ici 2030, avec l’aide précieuse de cartes d’évaluation par pays. En 2021, le paludisme a fait 619 000 victimes dans le monde avec 95 % des cas et 96 % des décès enregistrés en Afrique.
L’ALMA s’est dotée en 2021 de deux ambassadeurs spéciaux responsables de la coordination diplomatique et de faire l’interface avec les chercheurs de l’organisation : la professeure botswanaise Sheila Tlou et l’avocat kenyan Anthony Okara. Ce dernier a passé neuf ans de sa carrière au bureau du vice-président de la Commission de l'Union africaine et il revient pour Gavi sur la menace du nouveau facteur.
Comment la lutte contre le paludisme avançait-elle en Afrique ?
En moyenne nous progressions dans la bonne direction les cinq premières années d’ALMA. Le Kenya, par exemple, était en passe d’éliminer le paludisme en passant de 12% d’incidence de la maladie en 2012 à 6% en 2019. Nous aurions pu atteindre 0% d’ici 2030. Mais à partir de 2019, cela a commencé à ralentir et à stagner. Nous voulions relancer l’impulsion à travers la collaboration régionale grâce à une carte d’évaluation d’Afrique de l’Est et une collaboration transfrontalière, un partage des laboratoires de recherche et des informations, des stratégies communes et des échanges d'idées.
« Si le nouveau moustique devait se généraliser, tout ce que nous avons fait sera réduit à néant car nous avons structuré toute notre guerre contre le paludisme en fonction des schémas existants avec des parasites qui sévissent principalement dans les zones rurales. »
Là-dessus, le COVID est venu confirmer la stagnation. Avant l’épidémie, la mortalité annuelle due au paludisme en Afrique était tombée à environ 450 000 personnes par an mais ce chiffre est reparti à la hausse depuis. Nous menons des recherches pour savoir si c'est parce que nous avons détourné l'attention des activités liées au paludisme ou autre chose. La volonté étatique est énorme. Le problème, c'est la capacité des pays et l'environnement de gouvernance qui ralentit les efforts avec des évènements comme la guerre au Soudan qui rendent les interventions impossibles.
Le problème que nous rencontrons maintenant, c’est que les vecteurs résistent de plus en plus. Auparavant, les moustiques atteignaient la moustiquaire et tombaient morts. Aujourd'hui, ils dansent sur la moustiquaire et s'en vont. Si elles sont traitées, c'est pour réduire le nombre de vecteurs porteurs de la maladie. Même les tests ne sont plus aussi efficaces parce qu'apparemment nous obtenons des faux positifs ou des faux négatifs, ce qui n'arrivait pas auparavant. Tout est affecté.
Quelle menace le nouveau moustique fait-il peser sur l’Afrique ?
Si le nouveau moustique devait se généraliser, tout ce que nous avons fait sera réduit à néant car nous avons structuré toute notre guerre contre le paludisme en fonction des schémas existants avec des parasites qui sévissent principalement dans les zones rurales.
Le nouveau moustique est actif dans les zones urbaines, il est actif tout au long de la journée et de l'année et c'est ce qui le rend si effrayant pour nous. D’abord, les moustiquaires deviennent inutiles. Ensuite, nous planifions et budgétisons généralement des actions après la saison des pluies dans les zones rurales : renforcement des capacités des établissements de santé, approvisionnement en kits de test prêts à l'emploi, etc. Mais si la maladie s'étend sur toute l'année, la pression sera énorme.
Il était très choquant de constater que le motif de déplacement du nouveau moustique n’est pas linéaire. Il est entré à Djibouti, puis a sauté au Nigeria, avant de revenir en Éthiopie. Il se propage d'une manière que nous ne pouvons pas contenir, et nous ne sommes pas sûrs qu'il n’apparaisse pas au Sénégal puis en Afrique du Sud.
Quelle est la réponse sur le continent ?
Il n’y a pas encore de stratégie continentale. Déjà nous avions besoin d’améliorer celles en place pour faire face à la résistance émergente. Comment cela fonctionne-t-il à l’ALMA ? Il y a une réunion des chefs d’État une fois par an, en février, et nous allons leur fournir un rapport. Ils donneront leurs conseils à ce sujet. J’ai rencontré les experts régionaux il y a deux semaines et l'un des sujets abordés concerne les menaces de l’Anopheles Stephensi sur le développement de la malaria.
Espérons que d'ici là, les Centres africains pour la surveillance et la prévention des maladies (CDC) et d'autres experts nous auront donné des informations sur la réalité de la menace. Nous devons savoir si cette augmentation des cas est liée au nouveau moustique ou à autre chose. Mais la mortalité est plus faible qu’elle aurait été dans le passé avec cette incidence, peut-être sommes-nous en train de nous habituer à toutes ces menaces.
L'une des mesures les plus urgentes consiste à apporter notre soutien aux chercheurs et à leur accorder davantage d'attention. Il n'y a pas assez de discussions et de sensibilisation sur ce sujet.
Comment comptez-vous financer ces nouvelles interventions?
Entre 60% et 70% des financements d’ALMA viennent du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sous l’égide de l’ONU. Lors du réapprovisionnement de l’année dernière, nous n’avons pas atteint nos objectifs. Sur les huit milliards de dollars visés pour la malaria, seulement 4 milliards ont été atteints. Déjà, cette cible ne représentait que 50% de nos besoins et même si nous avions réussi, nous devons aller vers de nouvelles interventions, de nouveaux médicaments qui sont plus coûteux, ce qui signifie en acheter moins. Et là-dessus, un nouveau moustique, c'est un scénario cauchemardesque pour nous.
Pour aller plus loin
Aujourd’hui nous avons trois principaux défis : financiers, techniques et légaux. Il est très coûteux d'installer les machines et les équipements mais nous avons la chance que le gouvernement nous soutienne et il veille de près à ce que nous soyons financés par d’autres partenaires de développement. Ensuite, en matière de compétences et de capacités techniques, nous avons des défis d’amélioration des compétences et de développement de la main-d'œuvre dans la fabrication des vaccins, le processus lui-même est très complexe.
Aujourd'hui, nous nous efforçons d'inciter les États membres à poursuivre leur contribution afin de réduire cet écart. Nous avons réussi à collecter 2 milliards de dollars supplémentaires depuis. Nous devons faire prendre conscience que si l'on ne s'attaque pas au problème en Afrique, il va se propager à travers le monde. Nous nous tournons aussi vers la mobilisation des ressources domestiques et notamment du secteur privé.
Le défi financier, le nouveau moustique et les résistances qui se développent sont autant de problèmes dans notre lutte. Nous pensons que nous pourrions encore faire un sérieux effort pour éliminer la maladie d'ici à 2030, mais cela devient de plus en plus difficile et imprévisible en raison de ces nouveaux scénarios.
Suivez l'autrice sur Twitter : @C_Lacave