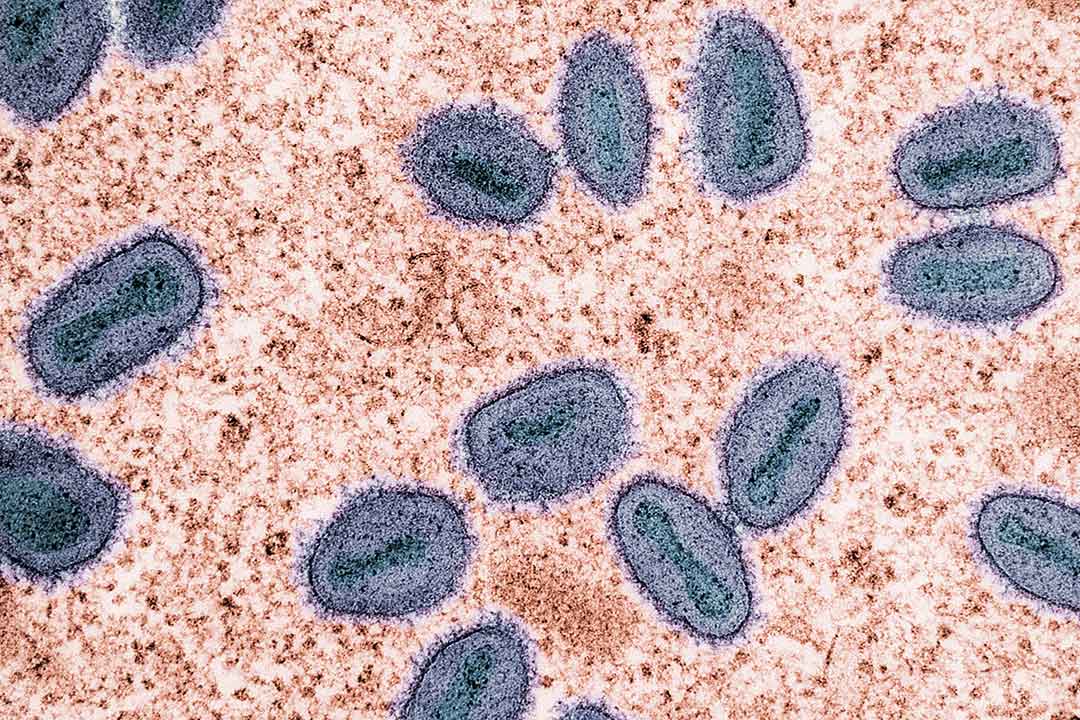Prévention du paludisme : l’enseignement de bonnes pratiques réduit les cas de plus d’un cinquième
Un essai mené au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire montre que l’enseignement de stratégies de prévention, combiné à l’usage de moustiquaires, permet de réduire les cas de paludisme d’un peu plus de 20 %. Son efficacité est comparable à celle de la pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations.
- 9 septembre 2025
- 3 min de lecture
- par Linda Geddes

On décrit souvent l’éducation comme une arme puissante. De nouvelles recherches suggèrent aujourd’hui que son impact contre le paludisme pourrait être plus important qu’on ne le pensait.
Une étude menée dans des zones rurales du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire a montré que l’association d’une sensibilisation au paludisme avec la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide réduit le risque de maladie autant que la pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations combinée aux moustiquaires.
Le paludisme est provoqué par un parasite transmis par la piqûre de moustiques infectés. L’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable a permis de réduire de façon spectaculaire le nombre annuel de décès liés à la maladie, mais les progrès se sont ralentis ces dernières années. Si le déploiement des vaccins antipaludiques commence à changer la donne, d’autres interventions pourraient encore avoir un impact majeur.
Que se sont-ils proposé de faire ?
Nicolas Moiroux, de l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal), et ses collègues se sont demandé si une communication intensive visant à modifier les comportements – c’est-à-dire enseigner comment réduire le risque de piqûres de moustiques et à quel moment consulter un médecin – pouvait contribuer à réduire l’incidence du paludisme parmi les habitants de villages ruraux du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, où l’accès à la télévision et à la radio est limité, lorsqu’elle est associée à l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide.
L’intervention a été menée par des agents de santé communautaires dans 12 petits villages situés dans des zones faiblement peuplées, accessibles uniquement en véhicule tout-terrain.
Ces agents ont animé des séances collectives et rendu visite aux habitants à domicile. Ils les ont encouragés à dormir chaque nuit sous une moustiquaire, et à maintenir leur environnement propre afin de limiter les lieux de reproduction des moustiques.
Les femmes enceintes ont également été incitées à prendre un traitement préventif contre le paludisme, tandis que les parents de jeunes enfants ont été sensibilisés à consulter un professionnel de santé dans les 24 heures si leur enfant présentait de la fièvre.
Les taux de paludisme dans ces villages ont ensuite été comparés à ceux de 16 villages ayant seulement reçu des moustiquaires imprégnées d’insecticide, ainsi qu’à 11 autres villages où moustiquaires et pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations étaient combinées.
Qu’a montré l’étude ?
Les résultats, publiés dans The Lancet Global Health, indiquent que la sensibilisation à la prévention du paludisme a entraîné une baisse de 22 % des cas de paludisme au cours des dix mois suivants, par rapport à l’utilisation seule des moustiquaires. Cet effet est comparable à celui de la pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations, qui a réduit de 23 % le nombre de cas enregistrés par les centres de santé.
« Bien que les programmes de communication pour le changement de comportement aient déjà montré des effets importants sur les pratiques de prévention, cette étude est la première à apporter une preuve épidémiologique de leur efficacité », soulignent les auteurs.
Pour aller plus loin
Quelles sont les implications de ces résultats ?
Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer l’efficacité de ce type d’intervention dans différentes populations, elles pourraient constituer un « complément prometteur » aux stratégies actuelles de lutte contre les moustiques, estiment la Dre Ellie Sherrard-Smith de la London School of Hygiene & Tropical Medicine et la Dre Corine Nguforin de la Liverpool School of Tropical Medicine (Royaume-Uni), dans un commentaire associé.
« Alors que les financements évoluent, les programmes de lutte contre le paludisme et leurs partenaires de mise en œuvre doivent diversifier leurs stratégies afin de maintenir les progrès accomplis contre la maladie », écrivent-elles.
Si les moustiquaires imprégnées d’insecticide demeurent une pierre angulaire de la prévention, « leur efficacité sur le terrain dépend largement d’une utilisation régulière et correcte au sein des ménages », ajoutent Sherrard-Smith et Nguforin.
« La communication pour le changement de comportement joue un rôle essentiel… en renforçant l’adhésion aux interventions et en garantissant que le bénéfice protecteur des moustiquaires imprégnées d’insecticide soit pleinement atteint et maintenu.
Au-delà de son impact direct, [elle] favorise l’engagement communautaire, construit la confiance, encourage une participation à long terme aux efforts de prévention et pourrait offrir une opportunité de consolider et d’amplifier les progrès dans la lutte contre le paludisme, à un moment où l’instabilité géopolitique continue de peser sur les financements et les chaînes d’approvisionnement. »
Elles ajoutent que de futures études devraient examiner le rapport coût-efficacité de ces interventions fondées sur la communication, en comparaison avec la pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations.