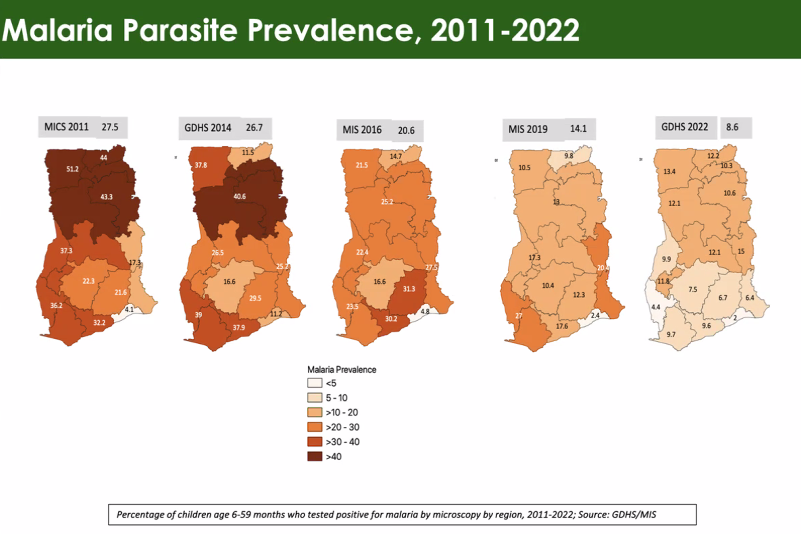Au Kenya, la lutte contre le cancer du col de l’utérus s’améliore enfin
En Afrique de l’Est, la prévalence des cancers liés aux papillomavirus atteint des niveaux records, encouragée par l’incidence du VIH, le manque de sensibilisation au sein des communautés et le faible taux de vaccination. Cependant, ces dernières années, des efforts accrus ont été déployés pour protéger les Kenyanes de cette maladie évitable.
- 9 février 2024
- 9 min de lecture
- par Claudia Lacave

« Quand j’ai appris que j’avais un cancer, j’ai été choquée. Sans parents, sans travail et avec deux enfants, j’étais très stressée alors je demandais à Dieu de m’emporter », raconte Philis Mastili, 43 ans, installée sur le canapé en bois de palettes de son amie. En ce chaud matin de janvier, en banlieue de la capitale Nairobi, elle revient sur sa perte d’espoir face à l’annonce d’une maladie encore synonyme de mort dans l’imaginaire de beaucoup de Kenyans. Pourtant, le cancer du col de l’utérus fait partie des plus faciles à soigner et surtout à prévenir. Cela, le Kenya l’a bien compris.
Alors qu’il s’agit du quatrième cancer le plus fréquent au niveau mondial, le cancer du col de l’utérus se classe au deuxième rang des cancers les plus courants au Kenya, juste après le cancer du sein. Avec 5200 victimes par an, il représente la principale cause de mortalité liée au cancer, entraînant le décès d'environ 9 femmes kényanes chaque jour. L'Afrique, en particulier, est fortement impactée, contribuant à hauteur de 21% de la mortalité mondiale en 2020, principalement en raison de la prévalence du VIH qui affaiblit la réponse immunitaire des patients.
« Je me souviens d’un jour où notre amie docteur avait rencontré une jeune femme avec un cancer du col de l’utérus assez avancé. Elle lui a donné une date de rendez-vous l’année suivante, presque 18 mois plus tard. Quelles étaient les chances que la patiente soit encore en vie à ce moment-là ? »
Dernier plan en date : une initiative de l’OMS et de l’entreprise suisse de biotechnologie, Roche, a été lancée fin 2023 à destination du Kenya, du Zimbabwe et de la Côte d’Ivoire pour trois ans. L’idée est de promouvoir la détection, l’établissement des diagnostics et le traitement des cancers du sein et de l’utérus, via un soutien encore à définir, et ainsi sauver la vie de nombreuses femmes.
Vivre avec un cancer
Dans le salon aux murs verts, un thermos de thé au lait et des morceaux d’arrow roots bouillies disposés sur la table nappée devant elle, Philis se rappelle le début du combat, en juin 2023 : « parfois j’avais des symptômes comme des pertes vaginales, des douleurs à l’abdomen, des odeurs et des démangeaisons intimes. » Deux dépistages à l’hôpital Kenyatta de Nairobi confirment le cancer du col de l’utérus, stade 1. Dans la plupart des cas, les symptômes ne se manifestent que beaucoup plus tard, généralement aux stades 3 ou 4. Cela se traduit par des dépistages tardifs, réduisant considérablement les chances de survie des patientes.
Les papillomavirus humains (VPH) sont les infections sexuellement transmissibles les plus répandues ; elles touchent 80% des gens sur Terre au moins une fois dans leur vie. Le corps se débarrasse en général naturellement de l’infection qui peut s’attaquer au col de l’utérus, l’anus, la vulve, le vagin, le pénis, l’oropharynx, la cavité buccale et le larynx. Mais parfois, l’infection devient persistante. « Quand vous contractez des VPH, cela prend 10 à 15 ans pour se développer en cancer mais pendant cette période, des lésions précancéreuses apparaissent. C’est pourquoi, si elles sont identifiées et traitées tôt, le patient peut s’en débarrasser », explique Emmah Kariuki, directrice des programmes de l’association kenyane Women4Cancer (Femmes contre le cancer).

Crédit : Claudia Lacave/Hans Lucas
Certains cofacteurs augmentent les risques de persistance des virus comme une infection au VIH, la consommation de tabac, le début précoce de l’activité sexuelle, l’expérience de partenaires sexuels multiples, l’utilisation à long terme des contraceptifs oraux combinés (œstrogènes et progestérone) et les grossesses multiples.
Après sa résignation initiale, Philis a réussi à remonter la pente grâce à des amis ayant survécu à la maladie et à se lancer elle-même dans le processus de diagnostic et traitement. Une cryothérapie lui a permis de se débarrasser des lésions et elle a commencé en septembre un traitement d’environ huit mois à base de sept pilules quotidiennes, ponctué de contrôles mensuels à l’hôpital. Les symptômes ont cessé. Sans emploi et donc sans assurance santé, elle a dû emprunter de l’argent à une amie et vendre ses objets de valeur pour se soigner.
Catherine Wachira, co-fondatrice de Women4Cancer, appuie : « Je suis contente d’affirmer qu’au Kenya, les services ne sont plus aussi chers dans le public qu’auparavant. Nous avons aussi des lignes directrices nationales en matière de dépistage avec la méthode d’Inspection Visuelle à l’Acide acétique (IVA), le frottis cervico-vaginal (test Pap) ou encore le test ADN. On parle de technologie améliorée, les choses changent. »
Lente mise en place et résultats récents
C’est avec trois autres amies, assises autour d’un thé hebdomadaire, que Catherine a créé l’association en 2012 face à un état des lieux frustrant. « Je me souviens d’un jour où notre amie docteur avait rencontré une jeune femme avec un cancer du col de l’utérus assez avancé. Elle lui a donné une date de rendez-vous l’année suivante, presque 18 mois plus tard, parce qu’à l’époque nous n'avions qu'un seul hôpital de référence national pour faire des radiothérapies. Quelles étaient les chances que la patiente soit encore en vie à ce moment-là ? » raconte-t-elle douloureusement.
Alors que le sujet était encore complètement neuf dans le pays, Catherine Wachira, Elizabeth Mbuthia, Dr Njoki Njirain et Benda Kithaka se sont lancées d’abord dans des campagnes de sensibilisation et ont ensuite développé l’association au fur et à mesure des besoins. Aujourd’hui, Women4Cancer organise des évènements de dépistage et le suivi des patientes à travers les différentes étapes de guérison, ainsi que leur financement ; elle travaille avec les gouvernements de comté à la formation des employés de santé et elle confectionne avec le ministère des outils de sensibilisation et des lois, le tout grâce à des donations privées.
Le pays moteur d’Afrique de l’Est a mis en place depuis 2009 des politiques et des directives cliniques, longtemps restées sans impact. Un bilan du Programme national de contrôle du cancer (NCCP) établissait en 2022 que la majorité des mesures manquaient de cadres d’application et de suivi et que les dépistages n’avaient « pas donné de bons résultats au Kenya ».
Pour aller plus loin
Le déploiement en 2019 du vaccin contre les papillomavirus, bien que tardif, a enclenché une progression rapide. « Après l'étude pilote de 2012, le Kenya devait aussi s’assurer la confiance de la population avant la phase d’application. Ensuite des accords ont été signés avec Gavi pour assurer la viabilité de l’approvisionnement des doses au cours des prochaines années avant que nous le prenions en charge à 100 %. Tout cela a pris du temps », détaille Catherine Wachira.
La COVID-19 a refroidi cet élan mais dès la fin de la crise, les indicateurs se sont améliorés rapidement. Le taux de dépistage a fusé de 11 % à 37,5 % des femmes de 25 à 49 ans entre 2018–2019 et 2022–2023 et 59 % des centres de santé pratiquent maintenant le test, quand ils n’étaient que 25 % en 2018. Les hôpitaux publics pratiquant la radiothérapie sont aujourd’hui au nombre de six et cinq autres établissements sont prévus dans les cinq prochaines années. Le NCCP a formé 7000 personnels de santé et fourni plus de 1000 dispositifs de traitement pour l'ablation thermique, mais la marge d’amélioration reste importante. Les taux de vaccination ont, eux, régressés : en 2021, 29 % des filles de 10 à 14 ans avaient reçu une dose et 44 % de celles-ci avaient obtenu la deuxième injection. En 2023, 28 % ont reçu la première dose et 24 % la deuxième, bien loin de l’objectif de vaccination complète de 90 % de l’OMS. L’organisation sanitaire recommande également que 70 % des femmes soient dépistées et que 90 % des cas positifs reçoivent un traitement.
« Ce que tu ignores ne te tue pas »
Au Kenya, le taux de traitement s’établissait à moins de 38 % des dépistés en 2022–2023 et la perte de suivi est un des principaux défis dans la lutte contre la maladie. « Dans le système public, il faut compter entre trois et six semaines pour obtenir les résultats d’une cytologie. C'est beaucoup car pendant ce temps, le cancer du col de l'utérus se développe », remarque Emmah pendant que Catherine ajoute : « Si vous demandez à quelqu'un de revenir après 6 semaines, il ne viendra pas à cause du coût et d'autres facteurs. » Le manque d’infrastructures rallonge les temps de trajet jusqu’aux hôpitaux et nombre de femmes ne sont pas en mesure de couvrir les frais des allers-retours, sans parler de ceux des soins. Le dépistage et les examens de précision du diagnostic ne sont pas remboursés par l’assurance santé publique bien qu’elle couvre la majorité des traitements eux-mêmes.

Crédit : Claudia Lacave/Hans Lucas
« Ce que tu ignores ne te tue pas », rapporte Pamela Savai, une survivante du cancer devenue militante qui entend souvent ce genre de rengaine. C’est pendant la première édition kenyane du mois de sensibilisation, en 2019, qu’elle a participé à un évènement de détection organisé par Women4Cancer. Grâce au soutien financier de l’association, en deux mois elle avait réalisé tous les tests et l’hystérectomie, une chirurgie d’ablation de l’utérus. Parce que ce dépistage lui a sauvé la vie, elle a décidé de s’engager avec l’organisation Kilele Health pour faire connaître ce cancer et elle participe à des levées de fonds pour les victimes grâce à des évènements de randonnée en montagne comme l’ascension du Mont Kenya ou du Kilimanjaro.
Malgré l’évolution des connaissances grâce aux campagnes d’information publique, les préjugés ont la vie dure. « Il y a beaucoup de stigmatisation. Quand je suis tombée malade, mes proches m’ont dit que j’étais victime de sorcellerie de la part de ma belle-famille. » Philis croise aussi ce genre de réactions lorsqu’elle parle de sa maladie, avec des à-priori comme : « Ça ne peut pas m’arriver », « Le cancer c’est pour les gens riches », « Qu'il me tue en silence ».
Les églises face à la vaccination d’une MST
Comme pour toute maladie sexuellement transmissible (MST), approcher les chefs religieux qui prônent l’abstinence et la fidélité au sein du mariage monogamique est un défi. Le cas des papillomavirus n’est pas différent et les guides spirituels ont d’abord montré une farouche résistance contre la vaccination. Une section de praticiens alliée à l'Association des médecins catholiques du Kenya affirmait que les doses contenaient des contraceptifs, qu’elles affecteraient la fertilité des femmes ou encore que la vaccination encouragerait l’activité sexuelle des enfants, le tout dans un contexte de désinformation sanitaire intense liée à la pandémie de COVID.
Avec le temps, l’expérience et les invitations régulières des chefs religieux aux forums de sensibilisation contre le cancer du col de l’utérus, les voix dissidentes se sont faites plus discrètes. « Ils comprennent que le vaccin ne concerne pas l’abstinence d’aujourd’hui, mais la protection du futur », dit Emmah Kariuki, directrice des programmes de l’association kenyane Women4Cancer. L’organisation est attentive à détacher la lutte contre la maladie de ses causes sexuelles pour faire accepter le message au plus grand nombre et dorénavant, même les églises invitent parfois des survivantes à témoigner et à encourager les dépistages. Emmah se souvient d’une mission dans le nord-est musulman du Kenya où un cheikh, après avoir été éduqué sur le sujet, a enseigné lui-même les risques et la prévention du cancer du col de l’utérus dans sa mosquée.
Suivez l'autrice sur Twitter : @C_Lacave