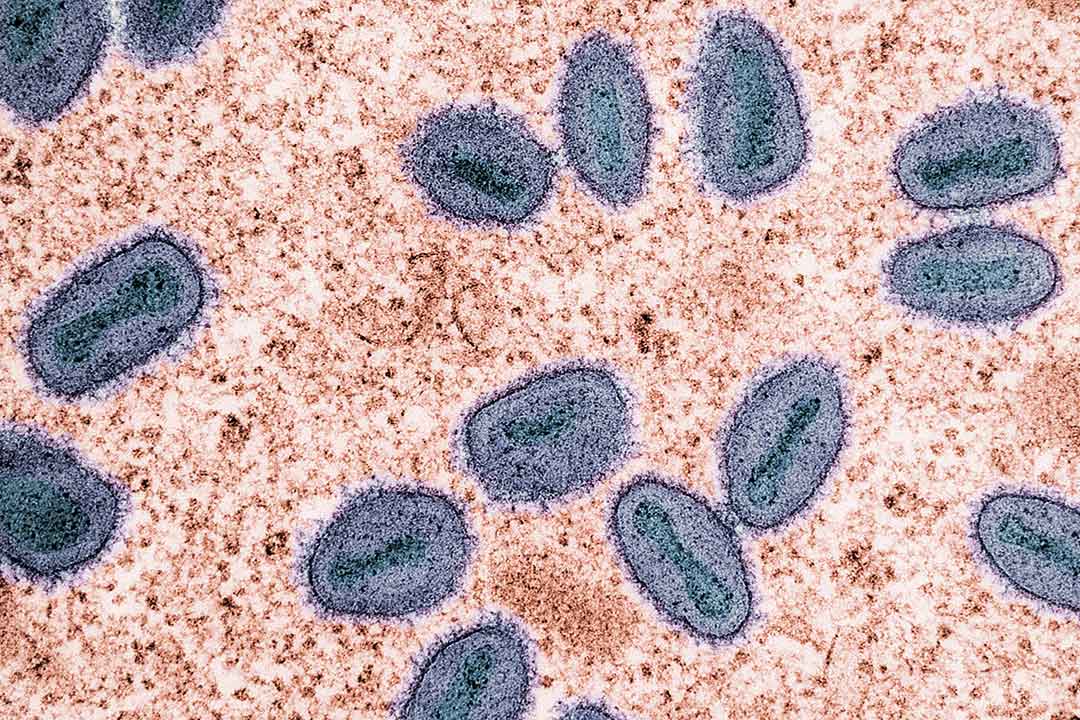Une nouvelle étude révèle comment le système immunitaire élimine le VPH
Une étude cartographie les réponses immunitaires à l'origine des infections non persistantes par le papillomavirus humain (VPH), la principale cause du cancer du col de l'utérus.
- 28 janvier 2025
- 3 min de lecture
- par Linda Geddes

Certaines infections par le VPH entraînent des cancers, d’autres non. Une nouvelle étude apporte un éclairage inédit sur la façon dont le système immunitaire élimine le VPH de l’organisme, ce qui pourrait à terme améliorer les traitements, le dépistage et la vaccination contre le cancer du col de l’utérus et d’autres maladies liées au VPH.
L’infection par le VPH est responsable de plus de 600 000 nouveaux cas de cancer chaque année, dont la quasi-totalité des cancers du col de l’utérus. L’infection chronique par le virus du papillome humain (VPH) en est la principale cause. Pourtant, 90 % des personnes infectées éliminent le virus spontanément de leur organisme en moins de deux ans et présentent alors un risque très faible de développer la maladie.
Malgré cela, on ignore encore beaucoup de choses sur la nature d’une réponse immunitaire saine contre le VPH, ainsi que sur l’évolution de la quantité de virus au fil du temps chez les individus infectés.
Pour étudier ces mécanismes, Nicolas Tessandier, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, et ses collègues ont recruté 189 jeunes femmes de la région de Montpellier. Pendant deux ans, ces volontaires se sont rendues tous les deux mois dans une clinique afin que les chercheurs puissent mesurer leur charge virale, les anticorps présents dans leur sang, ainsi que les populations de cellules immunitaires et les molécules de signalisation immunitaire dans la zone cervicale. Selon les auteurs, ces visites ont permis d’atteindre une « résolution sans précédent » pour comprendre la nature de ces infections.
« Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre la frontière entre les infections aiguës et chroniques, pour contrôler les maladies associées au VPH et pour la recherche sur les cancers humains d’origine infectieuse. »
- Nicolas Tessandier et collègues
Perspectives immunitaires
Publiée dans PLOS Biology, l’étude montre que les infections à VPH non persistantes se caractérisent par une forte augmentation de la charge virale, qui atteint un plateau environ deux mois après l’infection initiale et dure de 13 à 20 mois, avant de chuter rapidement.
Les chercheurs ont également constaté que certains marqueurs de la réponse immunitaire innée – la première ligne de défense de l’organisme contre les pathogènes – étaient associés à des formes plus légères d’infection, notamment une protéine appelée CXCL10, qui joue un rôle dans l’inflammation et la réponse immunitaire.
De plus, ils ont mis en évidence une forte corrélation entre un type particulier de cellule T immunitaire (activée lors d’infections virales) et la quantité totale de virus produits.
Une hypothèse avancée est qu’une fraction des infections à VPH parvient à échapper au système immunitaire inné et à instaurer une infection plus persistante, déclenchant alors une réponse immunitaire plus spécifique faisant intervenir les cellules T.
Pour aller plus loin
Cibles thérapeutiques
« Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre la frontière entre les infections aiguës et chroniques, pour contrôler les maladies associées au VPH et pour la recherche sur les cancers humains d’origine infectieuse », écrivent Tessandier et ses collègues.
Par exemple, les variations de la charge virale pourraient servir à optimiser les politiques de dépistage. Par ailleurs, une meilleure compréhension des mécanismes immunitaires pourrait contribuer à l’identification de nouveaux biomarqueurs et de traitements contre le VPH.
Cependant, seules quatre participantes ont été suivies alors qu’elles étaient infectées depuis 18 mois ou plus, ce qui limite pour l’instant la compréhension de la différence entre les infections chroniques et non persistantes. Un suivi prolongé pourrait apporter de nouveaux éclairages – notamment sur la manière dont les virus VPH évoluent chez leurs hôtes et sur leur potentiel lien avec le développement de cancers, expliquent les chercheurs.