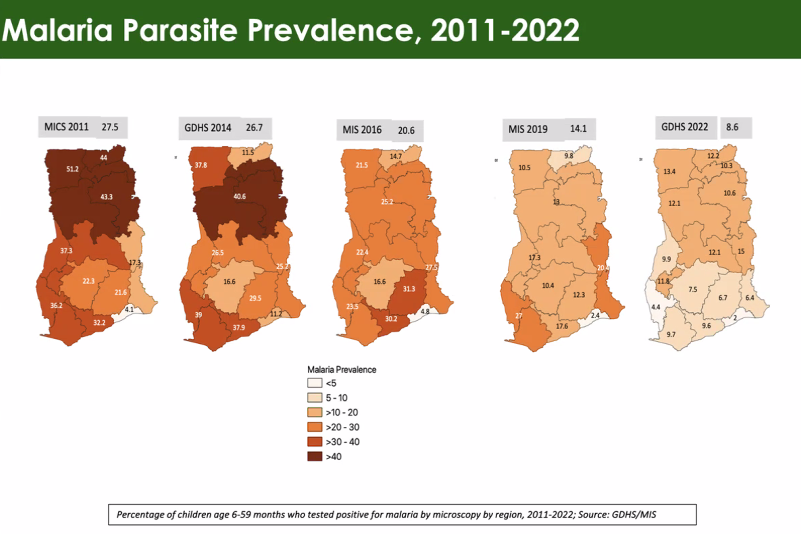60 ans plus tard, la santé des Kenyans
Le Kenya fête aujourd’hui les soixante ans de son Indépendance du pouvoir colonial britannique et pour l’occasion, VaccinesWork revient sur l’évolution du système médical et l’amélioration sanitaire de la population.
- 12 décembre 2023
- 10 min de lecture
- par Claudia Lacave

Aujourd’hui, le Kenya se classe 84ème dans le monde et 3ème sur le continent de l’indice de sécurité sanitaire mondiale (GHS Index) et se positionne à la pointe de la médecine en Afrique. Sa recherche médicale est reconnue à l’international et le pays accueille nombre d’essais cliniques, du vaccin contre la malaria au traitement injectable pour le SIDA. Pourtant, tout comme son gouvernement, son enseignement et son secteur économique privé, le pays a dû construire son système médical et sanitaire depuis soixante ans seulement, après l’Indépendance du 12 décembre 1963.
Soigner une population de 8,1 millions d’habitants dans les années 60, sans les revenus stables et conséquents d’un secteur industriel développé, sans les infrastructures de production des médicaments ni les infrastructures routières pour atteindre les zones reculées, le tout dans un environnement tropical propice au développement des maladies les plus mortelles et contagieuses, relève du miracle. L’évolution n’a pas été linéaire au fil des années entre la construction accélérée post-colonisation, le défi du financement et les lentes améliorations contemporaines entachées par la corruption du système.
La poussée post-indépendance
Dès sa prise de pouvoir, le Premier ministre du gouvernement provisoire, Jomo Kenyatta, a établi la santé comme domaine prioritaire, parallèlement à l’éducation et au développement économique. Le secteur médical est alors, pour l’Union nationale africaine du Kenya (KANU), un outil de promotion des bienfaits de l’Indépendance. En ligne de mire : la santé pour tous, en réaction au système racialisé instauré précédemment.
Le pouvoir impérial avait entrepris depuis 1921 la mise en place des services de santé sur le modèle européen avec la construction d’hôpitaux et de dispensaires organisés en un établissement national, des hôpitaux de provinces puis de district. Le système, basé sur la hiérarchie raciale qui justifiait la colonisation, dédiait les traitements thérapeutiques à la minorité blanche, venaient ensuite la population indienne, tandis que les Kenyans bénéficiaient d’une approche préventive de la médecine. Leurs maladies étaient considérées comme liées aux privations et à l’hygiène pendant que l’hypertension, l’obésité et les maladies cardiaques par exemple, identifiées comme « maladies de civilisation », n’étaient pas diagnostiquées. La population locale se tournait alors vers la médecine traditionnelle à base de plantes ou vers les missionnaires chrétiens, en dernier recours.
Le Kenya est un des rares pays africains à avoir mis en place un système de couverture dès les années 1960 pour lequel toutes les entreprises cotisent obligatoirement au nom de leurs employés.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’administration a renforcé le système à travers un plan décennal et l’implantation du concept de centre de santé inventé en Europe et testé en Afrique du Sud. Ces centres de campagne étaient particulièrement dédiés à former les mères à prendre soin et à nettoyer leurs bébés. Les docteurs étaient engagés en Grande-Bretagne ou en Inde, sous contrat de la fonction publique d'outre-mer, tandis que la main d’œuvre locale était principalement formée aux métiers d’assistants médicaux et d’infirmiers. Arrivé en 1963, un seul docteur kenyan, Dr. Leakman, était en poste alors que la majorité des professionnels britanniques avaient quitté le territoire, créant une pénurie de docteurs.
Les années 1960 à 1970 ont vu une rapide expansion des infrastructures et des services médicaux à portée multiraciale. Du préventif, le gouvernement s’est fortement tourné vers le curatif et la formation des médecins s’est accélérée grâce à l’Université d’Afrique de l’Est, basée en Ouganda, puis grâce à l’Ecole de médecine de l’Université de Nairobi, créée en 1969. À partir des années 1980, l’évolution a ralenti. Les hôpitaux ont commencé à être débordés par cette démocratisation de l’accès aux soins, les ressources matérielles et humaines ne suivant pas. « Cela a conduit à une contradiction très intéressante où l’establishment politique, très désireux d'assurer le développement social en termes de soins de santé et d'éducation, n'avait pas les moyens de faire grand-chose et a dû accepter l'aide des mêmes pays occidentaux qu'il fuyait », analyse le Dr. Kenneth S. Ombongi, président du département d’histoire de l’Université de Nairobi. Alors que la jeune République a eu recours aux financements internationaux dans le secteur de la santé dès son Indépendance, les années 80 et 90 ont marqué un investissement massif d’acteurs étrangers tels que AMREF, AMPATH, CDC ou encore le Wellcome Trust.
La décadence de fin du siècle
Après la période d’importants progrès médicaux et de développement à marche forcée, la situation s’est dramatiquement dégradée. « On a commencé à voir un niveau de décadence très élevé dans le système médical kenyan », décrit l’historien Ombongi. Entre 1963 et 1983, l’espérance de vie des Kenyans s’était améliorée de 48,4 ans à 58,8 ans mais a redescendu jusqu’à 51,7 ans en 2003. Le phénomène n’a pas touché seulement l’Afrique de l’Est ; tout le continent était concerné avec 40% des pays atteignant une espérance de vie inférieure à celle du début des années 70 d’après une étude de l’Institut kenyan de recherche et d'analyse des politiques publiques (KIPPRA) publiée en 2004.
Face au déclin des dépenses de santé, à l’utilisation inefficace des ressources, aux décisions centralisées, aux lois obsolètes et aux compétences de gestion inadéquates, les réactions gouvernementales ont eu des résultats mitigés. Ont été mis en place en 1994 le Cadre de la politique de santé (KHPF) pour établir une stratégie au long-terme, et en 1997, le Secrétariat à la réforme du secteur de la santé (HSRS) pour superviser l’application de cet agenda. Un audit du premier Plan stratégique national pour le secteur de la santé (1999-2004) a estimé qu’il n’avait « pas réussi à faire une percée en termes de transformation des interventions et opérations critiques du secteur ».

Crédit : Claudia Lacave/Hans Lucas
L’examen établit que le système n’est pas efficace et que les indicateurs sont en baisse. Entre 1993 et 1998, le taux de mortalité infantile a augmenté de 12% alors que le ratio médecin-population déclinait pendant les deux dernières décennies du XXème siècle. La santé représentait environ 8% de l'ensemble des dépenses publiques et une fois rapportée par habitant, s’élevait à 500 Ksh (6,2$), bien loin des 34$ recommandés par l’OMS. En ont résulté un manque généralisé de médicaments, une pénurie de personnel et le mauvais entretien des équipements, des transports et des installations de santé. Également inquiétant, la couverture vaccinale a diminué à cette période. L’immunisation complète est passée de 78% en 1993 à moins de 60% dix ans plus tard quand le quotient d’enfants zéro dose a augmenté de 3% en 1998 à 6% en 2003. Le rapport note une baisse globale de l’intérêt et du financement des services d’immunisation car moins de personnes mouraient de maladies vaccinables. En parallèle, le nombre d’établissements de santé a lui augmenté, pour atteindre 4 767 en 2004.
Pour aller plus loin
- L’Afrique se rêve à l'avant-garde de la R&D en Intelligence Artificielle
- Protéger les filles, sauver des vies : au Togo, le vaccin contre le papillomavirus fait son entrée dans la vaccination de routine
- L'Accélérateur de la Production des Vaccins en Afrique : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce crucial ?
Au-delà du manque de ressources humaines et financières, la dégradation coïncide avec l’arrivée du VIH. Le pays souffrait depuis la période pré-coloniale d’épidémies de variole, de peste bovine, de famine et du paludisme mais à partir de la moitié des années 1990, le VIH a pris le dessus comme principale cause de mortalité au Kenya. En infectant les adultes à leur âge le plus productif, en réduisant le nombre d’individus éduqués et qualifiés capables de former la prochaine génération de travailleurs et en produisant une grande quantité d’orphelins, la maladie a fortement impacté la croissance et l’état de santé global du pays. Malgré son apparition en 1981, la longue période d’incubation du virus a retardé la réaction de nombre de pays africains qui n’ont engagé des mesures qu’à partir des années 90 alors que beaucoup de personnes étaient déjà touchées. Le Kenya a développé de nombreuses stratégies contre l’épidémie mais l’insuffisance de l’approvisionnement en médicaments reste un problème de nos jours.
Tentatives de réformes moderne et lentes améliorations
Les indicateurs se sont progressivement redressés au cours de la première décennie pour atteindre un rythme de croisière. La part de la population vivant avec le VIH a notamment réduit de 10% à la fin du siècle à 6% en 2012 tandis que la population atteignait 43 millions de personnes et que l’espérance de vie remontait à 60 ans. Le nombre de docteurs diplômés a doublé entre 2006 et 2015 passant de 287 à 501 par an mais leur répartition n’était toujours pas satisfaisante, avec par exemple 32% des praticiens concentrés à Nairobi où ne vivaient que 8% de la population kenyane. Depuis le tournant du siècle, Kenneth Ombongi estime qu’aucune politique n’a permis d’évolution majeure malgré la volonté réaffirmée des gouvernements successifs. « À l’époque actuelle, nous avons essentiellement un système qui continue à essayer de faire ce qu'il est censé faire en matière de services médicaux et de recherche médicale, mais il ne le fait pas de manière optimale en raison de sa dépendance à l'aide étrangère et des cas de corruption bureaucratique au sein de notre ministère de la santé. »
Des tentatives de réforme ont pourtant bien eu lieu, comme celle de l’assurance maladie publique. Le Kenya est un des rares pays africains à avoir mis en place un système de couverture dès les années 1960 pour lequel toutes les entreprises cotisent obligatoirement au nom de leurs employés, les indépendants pouvant cotiser volontairement. D’abord gratuit, le partage des frais par les assurés, ou co-paiement, a été instauré au Kenya comme au Zimbabwe et au Ghana après 1989 sur demande expresse de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International dans le cadre de Programmes d'ajustement structurel (PAS) néo-libéraux. La mesure a certes généré des revenus pour l’Etat, à hauteur de 700 millions de shillings (9 millions de dollars) en 2001, mais a participé à la crise du système des années 90 en impactant négativement la santé de la population. Plusieurs études lient ces mesures d’ajustement à l’augmentation de la mortalité infantile et à la fermeture des établissements de santé. Un sondage démographique national de 1998 estime que « les progrès en matière de santé réalisés au cours des 25 premières années d'indépendance ont presque immédiatement disparu après l'introduction des PAS ».
Au début du millénaire, seulement 20% des Kenyans bénéficient du Fonds national d'assurance maladie (NHIF) alors même que l’institution est critiquée pour la mauvaise qualité des soins dans les établissements agréés, la lourdeur du processus de demande de remboursement et le manque de transparence et de responsabilité. Pour répondre à ces défis et augmenter la population protégée afin de tendre vers une couverture sanitaire universelle, le gouvernement a lancé en 2004 une nouvelle mouture, le Régime national d'assurance maladie (NHIS). Le Parlement a voté le texte en 2007 malgré la controverse qu’il provoquait entre les acteurs mais le Président, Mwai Kibaki à l’époque, a refusé de le ratifier, invoquant son coût élevé, et le changement de Ministre de la Santé en 2008 a mis fin à la tentative.
L’axe de la décentralisation a aussi été exploré au fil des années sans que l’amélioration des services ne soit flagrante. Le pays d’Afrique de l’Est a hérité de la colonisation d’une organisation fortement centralisée autour d’un pouvoir hégémonique, y compris dans le domaine sanitaire, mais n’a commencé à s’en inquiéter que vers la fin du siècle. Après 20 ans d’aspiration nationaliste forte, les dispensaires locaux ignorés sont revenus dans les discours officiels et les premières mesures ont été prises en 1983-1984, sous le nom de politique de développement rural. La Décentralisation des systèmes de gestion financière (DFMS) a pris place en 1994 en confiant aux districts les responsabilités de superviser et auditer les comptes de santé, d’approuver les plans de dépenses et d’organiser les formations médicales. Très rapidement, les autorités ont été submergées par le boom démographique et l’accès à la santé s’est dégradé, la décentralisation s’opposant à la viabilité financière du secteur et les districts luttant pour superviser plusieurs domaines techniques de la prestation de services à la fois.
En 2010, c’est l’entièreté du gouvernement qui a été emportée dans une vague de dévolution des services à la suite de la nouvelle Constitution. L’objectif était de promouvoir la démocratie dans les fonctions publiques, assurer le partage équitable des ressources nationales, motiver l’auto-gouvernance et protéger les intérêts sanitaires des communautés locales. Mais pour Kenneth Ombongi, la question reste la même : « Les problèmes rencontrés par le système de santé au niveau national ont été transférés au niveau local. Quand vous allez dans un hôpital de district, les défis ne sont pas très différents de ceux de l’hôpital national Kenyatta parce que les comtés n’ont pas pu consacrer suffisamment de ressources au développement des infrastructures, au développement des équipements, au développement de la formation du personnel. »
De nos jours, les difficultés de réforme et les ressources limitées du secteur de la santé au Kenya continuent de ralentir les progrès médicaux et l’amélioration de la santé de sa population, bien qu’elle vive maintenant jusqu’à 67 ans et que la mortalité infantile ait baissé à 28 décès pour 1000 nouveau-nés.
Suivez l'autrice sur Twitter : @C_Lacave